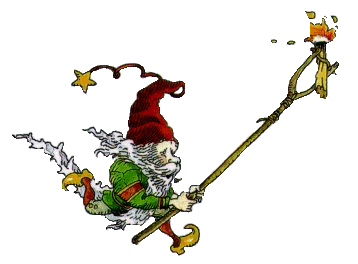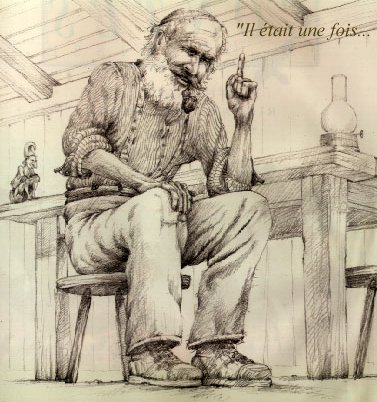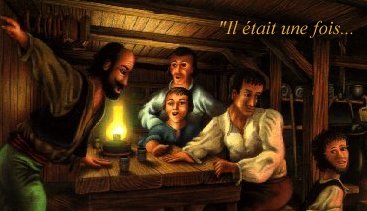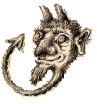|
|
Tradition orale
|
|
|
Introduction
" Et du pommier sont tombées trois pommes…
- La première, elle est pour le conteur,
parce que c’est toujours lui le premier servi. Tiens !
La deuxième, elle est pour toi, qui
a entendu l’histoire…
- Et la troisième, on va la partager
?
- Oui, mais pas comme tu crois !
  
Le conteur a ouvert la pomme,
et la première moitié, il l’a
lancée haut et loin derrière lui, à l’horizon !
- Cette moitié, elle est pour celui
qui a raconté l’histoire,
il y a bien longtemps, bien avant moi…
Et l’autre moitié, il l’a lancée
haut et loin, devant lui, à l’autre bout de l’horizon…
- L’autre moitié, elle est pour celui
qui racontera l’histoire bien plus tard,
quand ni toi, ni moi ne seront plus là,
ni pour l’entendre, ni pour la raconter."

Les contes et légendes participent tous deux d’une littérature
mouvante héritée de la tradition transmise de bouche à
oreille. Mais les contes désignent des récits merveilleux
mettant en scène des personnages fantastiques, alors que les légendes
puisent leurs racines dans l’histoire. Cependant, en Valais, la plupart
des conteurs se refusaient à employer ce genre de vocabulaire :
selon eux, les récits qu’ils rapportaient étaient des histoires
vraies, relatant des faits réels ou des expériences vécues.
Ainsi, comme on terminait jadis ces récits en disant en patois «
ça s’est passé vrai » on les commence aujourd’hui par
« il était une fois ».
L’œuvre populaire passe d’interprète à interprète.
Tout au long de cette chaîne de transmission, l’histoire se forme
et se transforme au gré du conteur, qui devient ainsi aussi auteur
le temps du récit. Ce sont toutes ces interventions successives
qui font la richesse de l’œuvre.
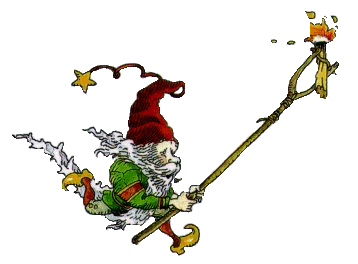
Les
conteurs et leurs histoires
Autrefois les histoires étaient innombrables.
Qui donc les racontait ?
En fait, il semble bien qu’il n’y ait pas eu de conteurs spécialisés.
Les femmes comme les hommes les racontaient, car chacun connaissait les
histoires. Mais durant les veillées, une
période de la journée qui leur était souvent presque
exclusivement dédié et qui réunissaient parfois plusieurs
familles autour de l’âtre, les vieux étaient d’abord sollicités,
car c’était eux qui connaissaient le plus d’histoires. On s’adressait
tout particulièrement à ceux que la nature avait fait bon
conteur, ceux qui « savaient raconter vrai ». Ils impressionnaient
leur auditoire par leur voie et leurs gestes, et surtout par leur mémoire
intarissable, véritable bibliothèque vivante.
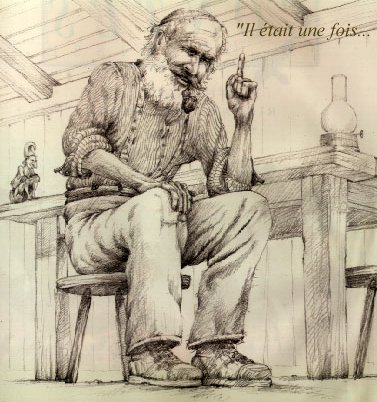
|
Toutes sortes d’histoires étaient racontées pendant
ses longues soirées :
des histoires à rire, des histoires à pleurer aussi,
des histoires fantastiques où surgit, souvent sur des bases moralisatrices,
le merveilleux, avec ses fées, ses
petits diables, ses dragons ailés,
les
vouivres et bien d’autres personnages fantastiques.
Il y a aussi un grand nombre d’histoires liées au mal comme
celles mettant en scène des catastrophes naturelles, le
diable, des sorciers et des sorcières
qui sont capables de jeter le mauvais sort sur le bétails ou sur
les gens.
A l’opposé, certains récits parlent de bons sorciers
qui, porteur de contre-pouvoir, peuvent combattre le mal.
|
Au delà de l’aspect purement récréatif, on peut
également considérer le conte comme l’un des principaux véhicules
de la transmission de la connaissance. En effet, ces récits ont
été largement utilisé à des fins pédagogiques
et éducatives. Les mères et les grands-mères surtout
les racontaient afin d’inculquer aux enfants un comportement social de
manière imagée, pour faciliter la compréhension et
la mémorisation des règles régissant la vie sociale
de l’époque.
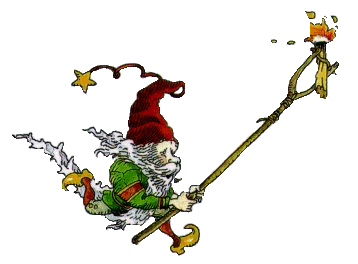
Les
veillées
Les histoires baignaient la vie quotidienne. On les racontaient à
la maison, sur la route qui menait aux champ ou aux pâturages, pendant
le travail. Mais c’est principalement le soir qu’elles jaillissaient, lorsque
la nuit tombait et que montait le froid, que les gens se réfugiaient
autour de l’âtre. Dans ce climat de pénombre et de mystère,
on commençait d’abord par parler du quotidien, de la terre, des
récoltes, du bétail. On jouait parfois aux cartes, parfois
également on dansait et on chantait. En fait, les veillées
étaient surtout et avant tout un lieu de rencontre et de parole.
D’une manière générale, elles privilégiaient
les relations sociales au sein de la communauté.
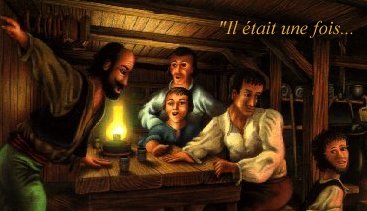
Mêlées à ce flots de paroles, il y avait les histoires.
Elles se racontaient et se transmettaient ainsi, comme toutes les autres
informations liées à la vie de tous les jours. Alors, à
mesure que la soirée avançait, on quittait le terrain stable
de la réalité pour s’ouvrir sur le monde du fantastique,
des légendes, des morts et des âmes en peine
qui viennent troubler la vie des vivants,
les avertir contre le danger ou les remettre dans le droit chemin.
Jean Follonier, un auteur valaisan, relate que
« dans mon village d’enfance, après
la mi-novembre, il s’agissait de meubler les longues soirées. Pour
cela, on n’avait pas besoin de l’électricité dont on ignorait
encore les bienfaits et les servitudes, et encore moins de la radio ou
de la télévision. On s’organisait entre voisins et, ainsi,
toute une vie sociale surgissait vers cette date et disparaissait à
la fin février, quand les hommes descendaient travailler les vignes.
Trois mois d’hiver, avec des veillées magnifiques, il n’est pas
possible d’oublier cela. »
L’auteur raconte ensuite que sa famille, ainsi que d’autres,
se retrouvait à la veillées chez Fabien, un homme qui
savait « conter des contes ».
Les récits se succédaient qui parlaient de légendes
locales plus ou moins assaisonnées selon l’humeur du conteur, de
revenants, de cris mystérieux de la montagne, de saints et du diable,
de géants maléfiques, et de bien d’autres figures du bien
et du mal.
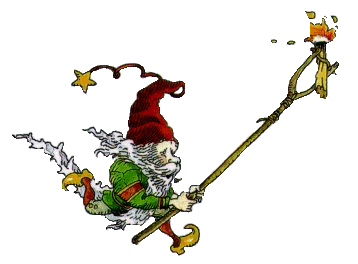
Les
sources
Le cadre et la source directe des contes et légendes du Valais
est le quotidien.
A la lecture des contes, on retrouve les trois espaces décrits
dans toute littérature, soit le lieu, le temps et l’action.
Le lieu, c’est bien entendu le Valais, terre de paysans, de travail
et de la nature.
L’espace du temps est celui du passé, les récits témoignant
d’une vie authentique,
souvent idéalisée.
L’action englobe quant à elle le temps
et le lieu et s’ancre profondément dans le domaine du quotidien.
Ainsi, avant d’être un divertissement,
les histoires sont surtout le reflet de la vie telle qu’elle se déroule
journalièrement.
Cette composante représente donc la partie « réaliste
» du conte,
qui se traduit notamment dans les récits par l’importance des
bêtes, du travail et de la religion. D’après Maurice Zermatten,
un autre écrivain valaisan,
« les contes populaires sont révélateurs
de la qualité des mœurs anciennes, d’une philosophie pragmatique
et concrète, d’une foi souvent voisine de la superstition ».
Cependant, le réalisme glisse très rapidement vers le
surnaturel dans les contes ;
au quotidien se mêlent le fantastique
et ces personnages étranges.
Ainsi, en plus de la réalité de la vie du valaisan, les
contes puisent-ils leurs racines dans une certaine forme de mythologie.
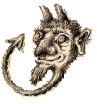
|
|