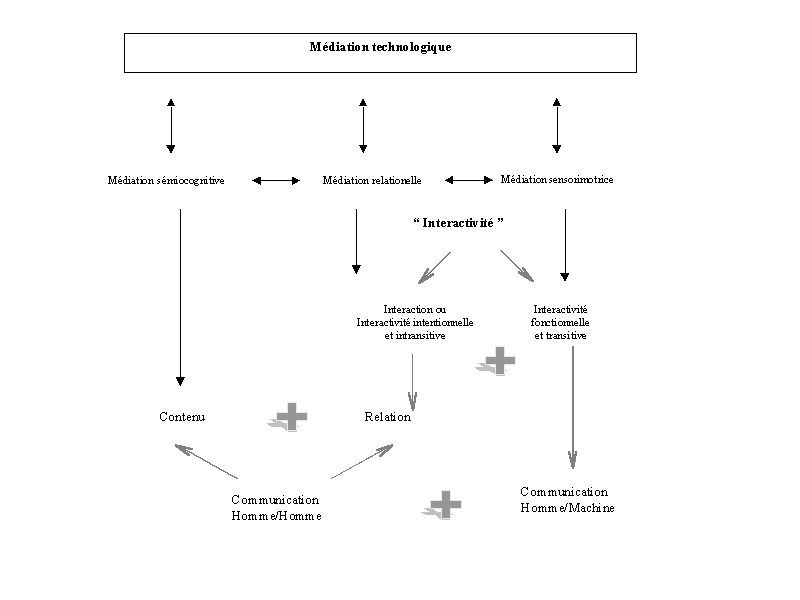
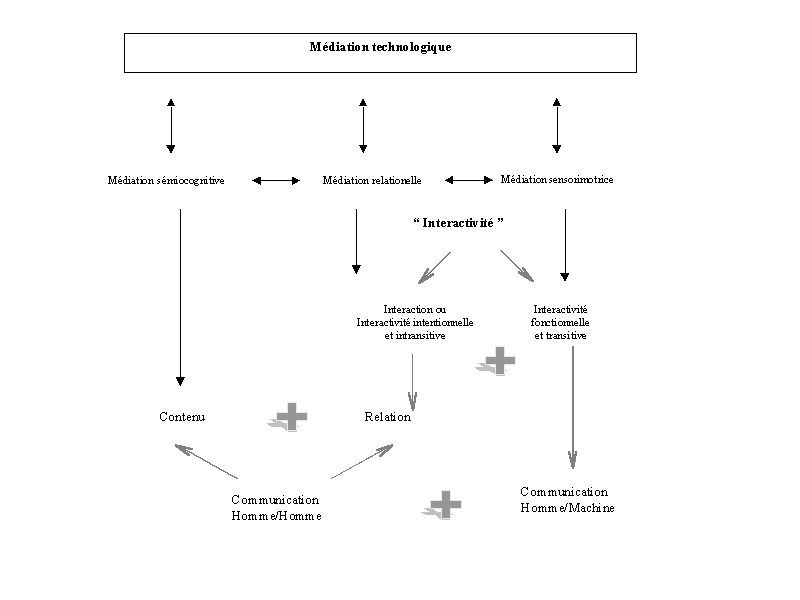
La médiation sensori-motrice
On connaît l'importance de la médiation
sensori-motrice chez Piaget. Pour ce dernier on le sait les images
figuratives naissent de l'imitation sensorimotrice intériorisée
sous la forme de schèmes. Plus récemment, Denis et de Vega
mentionnent les résultats d'expériences qui montrent que
toutes les dimensions spatiales (haut/bas, gauche/droite, devant/derrière)
ne sont pas égale-ment accessibles lorsqu'il s'agit pour des sujets
de restituer, à partir d'un modèle mental, les relations
spatiales entre différents objets. La dimension verticale apparaît
prédominante et la plus facile à discrimi-ner dans la mesure
où elle implique deux fortes sources de dissymétrie: la
gravité d'une part et la position canonique du corps humain d'autre
part [Denis, 1993:87]. Viennent ensuite les dimensions devant/derrière
alors que les dimensions gauche/droite, par manque de traits de différencia-tion
saillants, paraissent difficilement discernables. Et les auteurs de conclure
: Les modèles mentaux spatiaux sont biaisés par les connaissances
et par l'ensemble de l'expérience perceptivomotrice qui rendent
certaines dimensions plus accessibles que d'autres.
Il en est de même chez Lakoff et Johnson.
Dans l'approche expérientialiste de ces auteurs, nos concepts s'élaborent
à partir de notre insertion corporelle dans le monde et de l'expérience
préconceptuelle qui en découle. On trouve deux sortes de
structures dans cette expérience : les images schématiques
(comme les schémas haut-bas, contenant-contenu) et les catégories
du niveau de base conçues comme gestalts issues de nos interactions
avec le monde. L'ensemble de nos concepts, y compris les plus abstraits,
dérive de ces structures préconceptuelles par projection
métaphorique, ce dont attestent les multiples expressions métaphoriques
du langage ordinaire, lequel se révèle ainsi du même
coup comme gardien des conceptualisations culturellement fixées.
Outre son intérêt théorique, cette conception présente
également l'avantage d'offrir des outils d'analyse ; on y vient
dans la suite du texte.
La médiation sociale
Nous avons introduit cette notion fondamentale à partir du courant
de pensée prenant ses sources chez Piaget, Vygotsky et nous menant
aux travaux de Bronckart. Rappelons encore ce qui fonde les conceptions
de Vygotsky : toutes les fonctions sociales sont des relations sociales
intériorisées d'une part et les processus mentaux (internes,
individuels) conservent une nature quasi sociale.
Une notion essentielle à la dialectique inter/intra est celle
de décentration. Piaget en faisait le moteur du développement
cognitif autant que du développement moral. Il signifie que chaque
point de vue doit se percevoir comme relatif et se reformuler par la prise
en compte d'autres points de vue possibles. Le choc des pensées
qu'il implique est à l'origine de la réflexion comme processus
dynamique d'intégration des points de vue.
L'intérêt de la notion de décentration s'étend
largement au-delà de la seule psychologie du développement.
La notion de décentration à laquelle il faut adjoindre
son contraire, la centration concerne l'ensemble des rapports sociaux
dans la mesure où ceux-ci contiennent toujours de la représentation
mentale d'autrui ou du monde partagé. Dans ce contexte, ce qui
retiendra surtout l'attention ici, c'est que cette notion psychologique
et même socio-psychologique s'articule étroitement avec la
sémiopragmatique. Celle-ci a montré que toute communication
orale, écrite, audiovisuelle relève d'un dispositif d'énonciation
mettant en place un ou plusieurs énonciateur(s) s'adressant à
un ou plusieurs destinataire(s) au moyen de divers actes de discours de
forces variables. Il en découle un système relationnel qui
détermine largement les opérations de décentration
possibles pour les destinataires.
Cette remarque est capitale du point de vue éducatif (socio-éducatif).
Pour prendre un exemple la valeur éducative d'un film ou d'un reportage
dépend largement de sa capacité à provoquer la décentration
du spectateur et celle-ci dépend fortement de son dispositif d'énonciation,
de la manière dont, par exemple, celui-ci ramène tout ce
qui est dit à la vision d'un point de vue unique s'exprimant dans
un commentaire off (auquel cas il y aura centration) ou au contraire favorise
la traversée de divers points de vue, auquel cas on peut espérer
une décentration).
La notion d'interaction dont on fait beaucoup de cas aujourd'hui dans
les milieux concernés par la pédagogie semble fortement dépendre
de celle de décentration. A moins de réduire l'interaction
à quelques possibilités techniques de réponse, il
n'y a de véritable interaction que là où il y a possibilité
de décentration .
La médiation sémiotique
Venons-en maintenant au troisième type de médiation envisagé
: la médiation sémiotique. Celle-ci, du reste, est en rapport
étroit avec la précédente (mais nous n'envisagerons
pas ici cet aspect). Ce dont il s'agit ici, c'est du rapport qu'il peut
y avoir entre la pensée et ses opérations d'une part et les
signes externes analogiques et digitaux de la culture d'autre part.
Ce rapport, notons-le tout de suite, ne peut se concevoir qu'en termes
(systémiques) de circularité : la pensée se sémiotise
dans des signes extérieurs qui, en retour, déterminent les
formes de la pensée. Mais pour penser cette circularité,
il faut dissocier quelque peu les termes et envisager séparément
la pensée et les signes.
Dans la tradition constructiviste que nous avons évoquée,
il nous semble voir se dessiner un mouvement en faveur de l'iconicité
de la pensée et le caractère fondamentalement analogique
des opérations dont elle témoigne. Pour Lakoff et Johnson,
par exemple, les concepts sont conçus comme des gestalts issues
de l'expérience perceptive, interactive et les opérations
mentales de conceptualisation et d'inférence relèvent essentiellement
de projections et implications métaphoriques. Nous l'avons vu, pour
beaucoup de psychologues, même relevant de la tradition objectiviste
comme Johnson-Laird, la représentation mentale est conçue
comme modèle mental, c'est-à-dire un analogue du monde extérieur
construit par l'esprit humain, analogue sur lequel il peut effectuer des
opérations d'inférence qui relèvent plus de l'observation
et de la comparaison de modèles que de la logique formelle.
Pour le linguiste Langacker, avons-nous vu également, les mots
sont des instruments très raffinés de mise au point de l'imagerie
mentale au moyen de laquelle nous conceptualisons le monde. C'est ainsi,
écrit-il, qu'un locuteur qui observe la distribution spatiale de
certaines étoiles peut correctement y voir une constellation, un
agglomérat d'étoiles, des taches de lumières dans
le ciel, etc. De telles expressions sont sémantiquement distinctes
; elles reflètent des façons différentes de concevoir
la scène, chacune étant compatible avec ses propriétés
objectivement données. Je dirai qu'une expression impose une image
particulière dans son domaine (
).
(Extrait de Peraya, D. & Meunier, J.P. (1999) - Vers une sémiotique cognitive. In Cognito, 14, 1-16)